Récit à partir d’une photo (45 à 60’)
S. Méla, juin 2024
La veuve du cordonnier était un drôle de personnage.
C’est bien simple, elle semblait habiter le bourg depuis toujours, et à la mort de son mari elle n’avait pas changé une seule de ses habitudes.
Tous les matins à 7h30, elle ouvrait la porte de la boulangerie et demandait d’une voix fluette, mais ferme, son quart de miche de pain de campagne et un cannelé. Puis, elle filait à petits pas comptés jusque chez Mme Galignac, la coiffeuse, pour sa mise en pli quotidienne. Chaque jour de la semaine, sauf le lundi où elle lui demandait un shampooing et le premier jour du mois où elle avait sa coupe, elle quittait le salon à 8h15, ses cheveux soigneusement lissés et maintenus par un voile de laque fixation forte.
Elle entrait alors dans l’église Saint-Joseph où, après une génuflexion rapide et un signe de croix inspiré, elle s’enfermait dans le confessionnal et discutait trente minutes pile avec Monsieur le Curé. Ses péchés de la journée pardonnés, elle s’agenouillait alors devant son banc, toujours le même, celui qui faisait face à une statue de la Vierge à l’enfant, dont la facture ancienne avait souffert de la restauration ratée d’une paroissienne dévouée mais myope comme une taupe.
Deux Pater et trois Ave plus tard, elle ressortait comme elle était entrée, génuflexion et signe de croix légèrement plus appuyés cette fois, en signe de reconnaissance pour ce Seigneur qui lui avait nettoyé l’âme.
Elle retournait ensuite chez elle, dans sa petite maison du bout de la rue des Tanneurs, dont aucun habitant du village ne savait à quoi pouvait ressembler l’intérieur, vu que personne n’avait jamais été invité à y entrer.
De temps à autres, un nouveau venu tentait d’en savoir plus et abattait la petite main de bronze sur la porte de chêne plein qui donnait sur la rue. Il attendait là plusieurs minutes, devinant la silhouette de Mme Ebrard, derrière ses fins rideaux en voile de coton, qui l’observait en attendant qu’il se lasse et se décide enfin à faire volte-face parce qu’il n’avait pas que ça à faire, tout de même.
À force d’habitudes et de mystères, l’existence de Léontine Ebrard semblait à tous ceux qui la croisaient, réglée comme du papier à musique ; même si on était certain qu’elle n’en utilisait pas une simple feuille, vu que personne n’avait jamais entendu une seule note s’élever du 17 rue des Tanneurs.
Et pourtant, Léontine avait un jardin secret, qui était justement son jardin.
Oh, il n’était pas bien grand, à peine la taille d’une courette donnant sur l’arrière de sa maisonnette. Elle y passait tant de temps et y avait mis tant de cœur que c’était devenu un minuscule paradis.
Avant le décès de son mari, elle ne s’y était pas intéressée le moins du monde. Elle était déjà bien occupée à lui faciliter son existence : cuisinière, lavandière, repasseuse, femme de ménage, comptable… Nombreuses avaient été ses casquettes et elle n’avait guère eu le temps de se distraire.
Mais, une fois les funérailles passées, les remerciements envoyés, la visite chez le notaire expédiée et la somme des formalités accomplie, elle s’était assise dans l’atelier de son Joseph, et là, dans la bonne odeur de cuir et de cirage, entourée de la demi-douzaine de souliers, jamais récupérés par leurs propriétaires, elle avait pleuré pour la première fois depuis des années.
Il fallait finir de faire le vide pour céder la boutique à un jeune ; cela lui semblait au dessus de ses forces. Alors, elle avait attrapé de ses bras vigoureux toutes les chaussures restantes, et incapable de les jeter, elle les avait rapporté dans ce qui avait été leur foyer, qui ne serait désormais plus que le sien.
Elle les avait disposé harmonieusement dans la cour, comme si une assemblée d’amis venait de se déchausser en entrant chez elle.
Le temps avait fait le reste : la pluie, les graines apportées par le vent ou les oiseaux avaient doucement investi les semelles. En découvrant que du pourpier s’était épanoui dans des chaussures de marche, que du lichen avait investi un mocassin verni, Léontine avait continué l’œuvre de la nature. Elle avait installé de tout petits cactus dans des escarpins, un joli géranium dans une botte, et, tout doucement, son petit jardin de cordonnier avait pris forme.
Elle y passait désormais l’essentiel de ses journées, à observer les plantes plutôt qu’à les tailler ou les entretenir. Elle trouvait dans ce carré de nature désordonnée et fantasque, une sérénité bienfaisante.
C’est bien simple, elle semblait habiter le bourg depuis toujours, et à la mort de son mari elle n’avait pas changé une seule de ses habitudes.
Tous les matins à 7h30, elle ouvrait la porte de la boulangerie et demandait d’une voix fluette, mais ferme, son quart de miche de pain de campagne et un cannelé. Puis, elle filait à petits pas comptés jusque chez Mme Galignac, la coiffeuse, pour sa mise en pli quotidienne. Chaque jour de la semaine, sauf le lundi où elle lui demandait un shampooing et le premier jour du mois où elle avait sa coupe, elle quittait le salon à 8h15, ses cheveux soigneusement lissés et maintenus par un voile de laque fixation forte.
Elle entrait alors dans l’église Saint-Joseph où, après une génuflexion rapide et un signe de croix inspiré, elle s’enfermait dans le confessionnal et discutait trente minutes pile avec Monsieur le Curé. Ses péchés de la journée pardonnés, elle s’agenouillait alors devant son banc, toujours le même, celui qui faisait face à une statue de la Vierge à l’enfant, dont la facture ancienne avait souffert de la restauration ratée d’une paroissienne dévouée mais myope comme une taupe.
Deux Pater et trois Ave plus tard, elle ressortait comme elle était entrée, génuflexion et signe de croix légèrement plus appuyés cette fois, en signe de reconnaissance pour ce Seigneur qui lui avait nettoyé l’âme.
Elle retournait ensuite chez elle, dans sa petite maison du bout de la rue des Tanneurs, dont aucun habitant du village ne savait à quoi pouvait ressembler l’intérieur, vu que personne n’avait jamais été invité à y entrer.
De temps à autres, un nouveau venu tentait d’en savoir plus et abattait la petite main de bronze sur la porte de chêne plein qui donnait sur la rue. Il attendait là plusieurs minutes, devinant la silhouette de Mme Ebrard, derrière ses fins rideaux en voile de coton, qui l’observait en attendant qu’il se lasse et se décide enfin à faire volte-face parce qu’il n’avait pas que ça à faire, tout de même.
À force d’habitudes et de mystères, l’existence de Léontine Ebrard semblait à tous ceux qui la croisaient, réglée comme du papier à musique ; même si on était certain qu’elle n’en utilisait pas une simple feuille, vu que personne n’avait jamais entendu une seule note s’élever du 17 rue des Tanneurs.
Et pourtant, Léontine avait un jardin secret, qui était justement son jardin.
Oh, il n’était pas bien grand, à peine la taille d’une courette donnant sur l’arrière de sa maisonnette. Elle y passait tant de temps et y avait mis tant de cœur que c’était devenu un minuscule paradis.
Avant le décès de son mari, elle ne s’y était pas intéressée le moins du monde. Elle était déjà bien occupée à lui faciliter son existence : cuisinière, lavandière, repasseuse, femme de ménage, comptable… Nombreuses avaient été ses casquettes et elle n’avait guère eu le temps de se distraire.
Mais, une fois les funérailles passées, les remerciements envoyés, la visite chez le notaire expédiée et la somme des formalités accomplie, elle s’était assise dans l’atelier de son Joseph, et là, dans la bonne odeur de cuir et de cirage, entourée de la demi-douzaine de souliers, jamais récupérés par leurs propriétaires, elle avait pleuré pour la première fois depuis des années.
Il fallait finir de faire le vide pour céder la boutique à un jeune ; cela lui semblait au dessus de ses forces. Alors, elle avait attrapé de ses bras vigoureux toutes les chaussures restantes, et incapable de les jeter, elle les avait rapporté dans ce qui avait été leur foyer, qui ne serait désormais plus que le sien.
Elle les avait disposé harmonieusement dans la cour, comme si une assemblée d’amis venait de se déchausser en entrant chez elle.
Le temps avait fait le reste : la pluie, les graines apportées par le vent ou les oiseaux avaient doucement investi les semelles. En découvrant que du pourpier s’était épanoui dans des chaussures de marche, que du lichen avait investi un mocassin verni, Léontine avait continué l’œuvre de la nature. Elle avait installé de tout petits cactus dans des escarpins, un joli géranium dans une botte, et, tout doucement, son petit jardin de cordonnier avait pris forme.
Elle y passait désormais l’essentiel de ses journées, à observer les plantes plutôt qu’à les tailler ou les entretenir. Elle trouvait dans ce carré de nature désordonnée et fantasque, une sérénité bienfaisante.
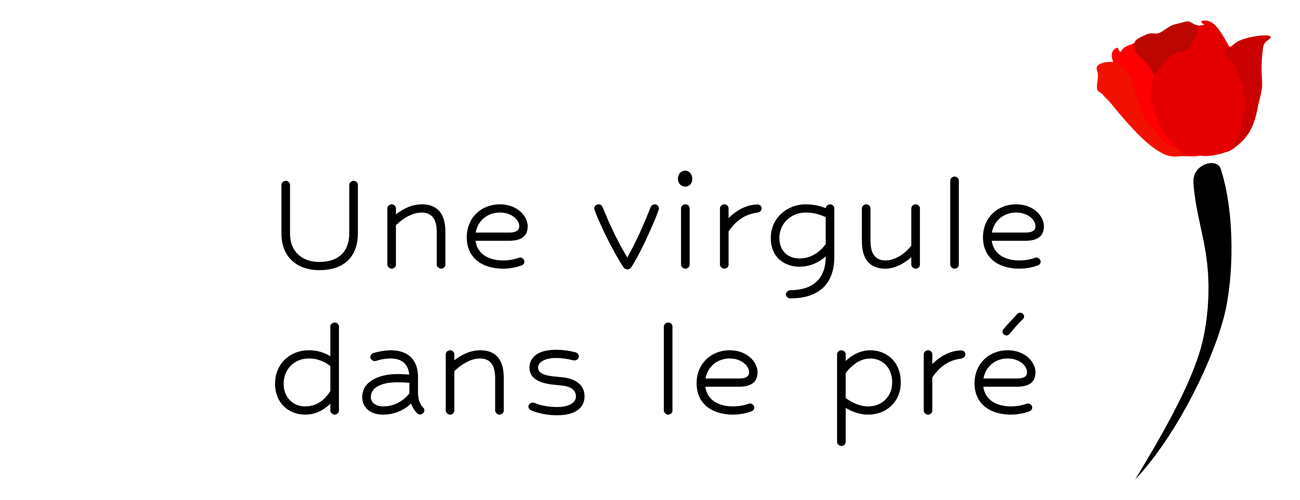
Commentaires
Enregistrer un commentaire