Note à l’intention des auteures[1] d'Un jour, une femme tombe
Parce qu’un auteur manque de recul pour corriger son propre texte, qu’il a déjà lui-même écrit et réécrit, corrigé, allégé à de multiples reprises. Il a souvent passé de longues heures à peaufiner une phrase, changer un paragraphe, en se posant mille questions, seul face à lui-même. L.-F. Céline, et M. Proust ont raturé et repris des pages entières.
• Rendre publique
Le texte édité (ou en cours de l’être) sort de l’antre de la création. L’auteur n’est plus en tête à tête avec lui, il le donne à lire à l’Autre. Il le donne au monde. Si l’écriture est la gestation du livre, sa publication est son accouchement. L’éditeur est là pour l’aider à naître, à vivre en société.
En effet, si un auteur écrit, c’est pour être lu, pour communiquer. Son message doit être fort et non se perdre dans la foule d’autres messages. Il doit être percutant, il faut donc parfois l’alléger pour lui donner plus d’intensité. Ce ne sont pas les détails qui font la force d’un texte, mais ses mots directs et bien choisis. Ainsi, il est parfois plus percutant d’écrire : « Elle recouvre l’ouie » que « Elle est comme une sourde qui recouvre l’ouie ».
Raconter une histoire qui nous est arrivée nécessite de la simplifier : les bons/les méchants, les bourreaux/les victimes, les terroristes/les hommes de paix, les riches/les pauvres, les logés/les sans logés… « Seule la fiction permet de rendre l’histoire dans sa complexité. C’est la victoire de la fiction sur le document. […] C’est la victoire de la fiction de permettre de regarder en arrière, vers l’enfer, de le réinventer, faute de pouvoir le redire. », écrit R. Monserrat (écrivain chilien, animateur d’atelier d’écriture qui a choisi comme ultime terre d’asile la littérature). Il ne s’agit pas de tout dire, de perdre le lecteur dans les méandres de l’intrigue, mais de lui donner à voir, de lui faire sentir. Il faut lui laisser sa part d’espace, sa part de créativité pour qu’il reconstruise l’histoire mentalement, qu’il soit touché et non envahi.
• La musique d’un orchestre
Vous, les auteures, êtes porteuses d’un message, votre conte est une pierre jetée dans la marre. On doit entendre sa chute, percevoir les ondes qu’elle émet. Il faut aller à l’essentiel pour ne pas perdre le lecteur en route, l’accrocher dès les premières lignes, et le garder près de soi jusqu’à la fin.
Il ne s’agit pas de réécrire pour réécrire. Il s’agit d’ôter ce qui est en trop, alourdit inutilement le texte et l’affaiblit. Il s’agit de l’améliorer, d’en souligner la quintessence. Ainsi on supprime ce qui est redondant et, quand il y a plusieurs auteur·es, le risque est grand qu’ils ou elles se répètent les un·es les autres. Ce n’est pas parce qu’une phrase est mauvaise en elle-même qu’elle est retirée, mais parce qu’elle ne s’intègre pas bien dans l’ensemble. Chaque phrase doit se fondre dans un tout afin que le lecteur ne perçoive pas le changement de style, les coupures de rythme qui pourraient le gêner et l’inciter à abandonner l’ouvrage.
Encore une fois, l’auteur ne doit jamais oublier son lecteur, il ne le lâche pas. Quand il se relit, il se met à sa place, c’est pour lui qu’il ou elle écrit. Comment ce paragraphe est-il compris, qu’ai-je voulu dire, ce mot-là est-il indispensable, etc.? Telles sont les questions que tout correcteur/auteur/éditeur doit se poser à la relecture.
• Trop d’épices tuent le goût
Parfois, le correcteur supprime un terme, une phrase. « Alors quoi, pourrait rétorquer l’auteur·e qui a sué tant d’heures pour écrire ce passage, vous me l’enlevez ? » Certes, mais le travail d’un écrivain, c’est aussi de raturer. Il faut parfois écrire des pages et des pages pour ne garder que la crème, deux ou trois paragraphes. Mais ces deux paragraphes sauvés et dont il ou elle est si fier·e aujourd’hui n’existeraient pas s’il n’en avait auparavant écrit des dizaines qui gisent, papiers froissés dans la poubelle. Écrire est une affaire de cuisine : trop d’épices tuent le goût. C’est aussi une affaire de peinture. La sous-couche ne se voit pas ; elle est pourtant indispensable, car elle détermine la qualité de l’ensemble, la partie visible.
• Ce qui fait sens
On peut garder les digressions si elles ont du sens, sens poétique ou autre. Ainsi dans Une femme tombe, les petits mots décalés de mademoiselle DSQT (une femme qui existe bel et bien et qui malgré ses délires s’est intégrée dans le groupe, qui l'a acceptée telle qu’elle est) symbolisent une femme qui vit en décalage et la problématique même du sentiment d’exclusion : être hors du temps, dans l’attente… Ses petits mots, pleins d’humour, donnent une poésie à l’ensemble du texte, parfois dramatique, et sont des clins d’œil au lecteur interpellé. La folie existe en chacun de nous, nous la côtoyons de façon plus ou moins proche ; elle fait partie de la réalité de notre monde et de ce que vivent les auteures de cet atelier d’écriture. Celles-ci traversent la vie et puisent dans leur humour et leur regard la force de supporter l’insupportable. Elles ne sont pas misérables, et témoignent ici de leurs étonnantes ressources. Elles tricotent et tissent l’ouvrage qui les libérera des mots, peut-être des maux ? Et pour reprendre les termes de Ricardo Monserrat : vous êtes les auteures de votre vie, de la fiction et non les victimes d’une vie, les victimes d’une Histoire.
• Lâcher, faire confiance
En aucun cas, l’éditeur ou le correcteur ne doit changer le sens, déformer les propos de l’auteur. C’est un travail de traduction, « à la dentelle », il doit respecter le style, le ton. Rester dans la vérité de l’auteur. C’est pour cette raison que ce dernier peut laisser son texte en toute confiance. Il s'agit là d’estime et de respect mutuel.
Car écrire, c’est lâcher. Faire confiance à celui qui édite, aide à mettre l’enfant au monde. Écrire nécessite du courage, écrire ensemble demande encore davantage de courage, vous l’avez eu. Vous avez eu le courage de vous écouter, de vous répondre, de vous donner la main. De cette écoute est né le conte. Vous avez su intégrer vos différences et dépasser vos a priori, vos difficultés. C’est ce courage qui affleure dans le conte. C’est ce courage que le lecteur sent. Il ne voit pas les ficelles de la création, ne devine pas les sous-couches, les aspérités qui président à la création. Sa lecture doit lui sembler limpide et les phrases, belles et simples à la fois. Cette évidence le tient en haleine. Tel est le pari !
C’est ce pari qui a permis à Raymond Carver, auteur américain issu des ateliers d’écriture et qui écrivait des nouvelles dans la misère, de sortir de l’ombre. L’éditeur qui sentait l’air du temps, ce que les lecteurs potentiels attendent (car le livre est aussi un produit commercial), a proposé à R. Carver de reprendre une grande partie de ses nouvelles, l’incitant à couper, et couper encore pour en faire des nouvelles brèves, très épurées. C’est cette brièveté, ce tranchant des mots et des histoires, particulièrement originaux, qui ont été appréciés et Carver est devenu l’un des plus grands nouvellistes de son temps. Il a créé un style. Son manuscrit initial aurait-il eut autant de succès ? Carver peut-il se reprocher d’avoir fait confiance à son éditeur ? C’est aujourd’hui encore en débat. Je vous invite d'ailleurs à lire ses ouvrages réédités par les éditions de l’Olivier. À nous d’en juger à la lecture…
[1] Dix résidentes d’une maison de stabilisation, accueillant des femmes sans domicile fixe, se sont réunies collectivement, durant un an, en atelier d’écriture hebdomadaire, pour composer un roman à plusieurs mains Un jour, une femme tombe. Le roman, préfacé par Jean-Luc Nancy, devait voir le jour aux éditions Anabet, peu avant la regrettable fin de la dite maison.
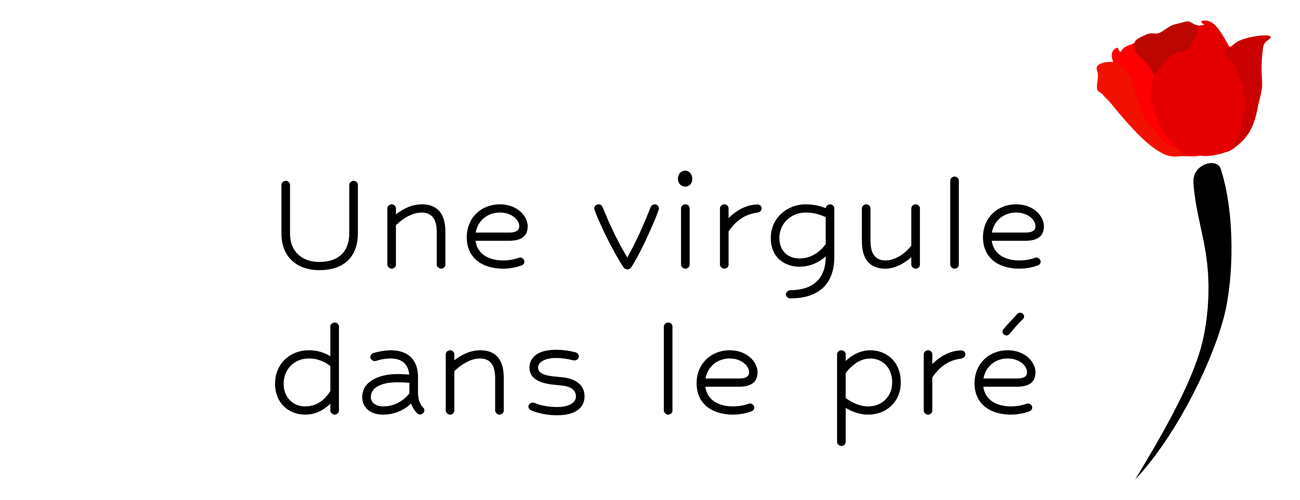
Commentaires
Enregistrer un commentaire